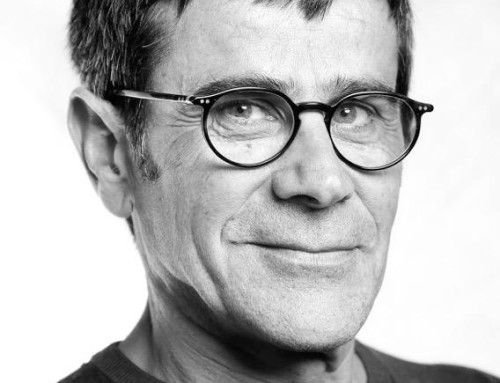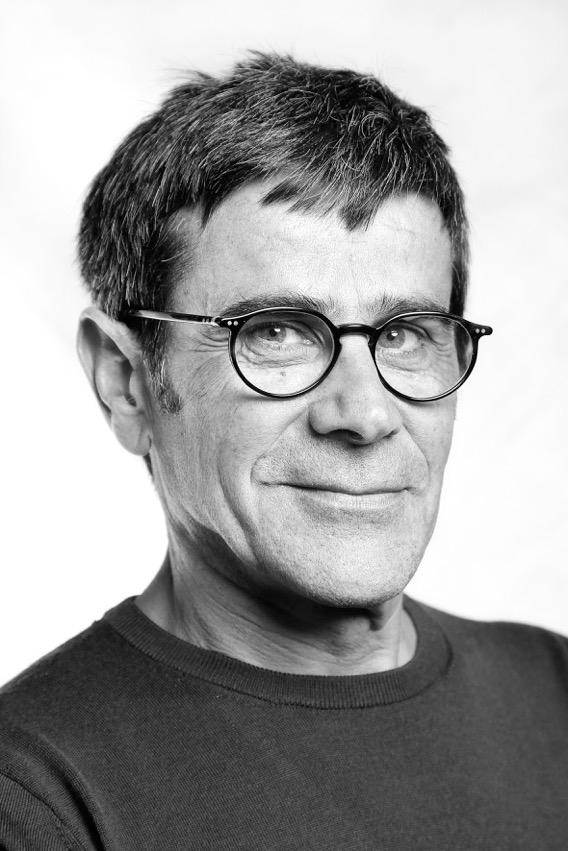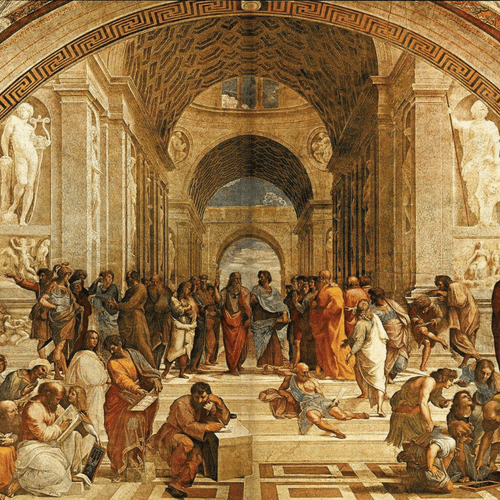Laura Bourdy incarne la 16ᵉ génération d'une famille de vignerons installée à Arlay, au cœur du Jura. Elle cultive ses vignes en biodynamie, dans le respect des cycles naturels et des savoir-faire anciens. Le domaine est réputé pour ses vins de caractère, dont de rares vieux millésimes soigneusement conservés.
Partenaire du Sommet du Luxe et de la Création 2025 dédié à la transmission, vous nous avez fait découvrir trois de vos vins le 19 juin dernier, lors du cocktail déjeunatoire et du dîner de gala. Pourquoi ce sujet de la transmission est-il si important pour vous ?
La transmission est le mot le plus important depuis 1579, date de création du Domaine par mes ancêtres. Transmettre, c'est faire vivre et perpétuer les spécificités et le respect des sols mais aussi la connaissance de la culture de la vigne et de la vinification … C'est aussi plus globalement une philosophie du vivant liée au lieu et de l'innovation à travers des pratiques agricoles renouvelées, relevant de la biodynamie..
Ce mot a également une résonnance particulière car je serai la première femme à transmettre. En effet jusqu'à présent le domaine a toujours été transmis de père en fils ou de père en fille.
Vous venez de nous rappeler que votre Maison a été fondée en 1579, quels sont les principaux défis que vos ancêtres ont réussi à surmonter pour transmettre leur savoir-faire et leur Domaine au cours des 446 années passées ?
Les principaux défis relèvent justement de la capacité de transmission génération après génération, sachant que les modes de consommation comme les modes agricoles changent à chaque renouvellement de génération. Il a fallu évoluer avec son temps. Et ce qui est drôle, c'est que nous revenons aujourd'hui à des pratiques agricoles considérées archaïques il y a encore quelques années.
Parmi toutes les crises, la plus dure à surmonter a été celle du phylloxera, ce puceron ravageur, qui a privé mon arrière arrière arrière grand-père, François Bourdy, de récolte pendant 10 années. Il a dû tout arracher puis replanter dans la seule perspective de transmettre le domaine à son propre fils.
Quels sont les défis auxquels vous vous êtes confrontée ?
Je pourrais en évoquer plusieurs, mais trois me semblent particulièrement marquants.
Le premier est personnel : je suis une femme dans un univers encore largement masculin. Même si les mentalités évoluent, cela demeure un défi en soi. Il faut, plus que jamais, faire ses preuves, démontrer ses compétences avec une constance souvent plus exigeante. Cela dit, je tiens à souligner qu'au sein du vignoble jurassien, je n'ai jamais rencontré de véritable misogynie — une singularité précieuse.
Le second défi est lié à l'évolution fulgurante de la viticulture. Les pratiques changent, les techniques se renouvellent sans cesse, et il faut s'adapter, toujours. Certaines innovations sont les bienvenues, notamment celles qui allègent la pénibilité du travail. Mais la vigne n'est pas une usine : elle exige encore des gestes précis, des attentions humaines que la machine ne peut remplacer. La taille douce en biodynamie, par exemple, est un savoir-faire que seule la main peut transmettre — et que nous avons le devoir de préserver.
Enfin, le troisième défi, que je place à égalité avec les précédents, est double : le changement climatique et la pénurie de main-d'œuvre. Nous sommes à la merci de la nature, et il nous faut constamment inventer des solutions pour que nos domaines puissent lui résister.
J'ai grandi avec la biodynamie. Je sais qu'elle n'est pas une simple philosophie agricole, mais aussi une réponse, vivante et sensible, au réchauffement climatique. L'agroforesterie, qui mêle haies, arbres et vignes, incarne cette intelligence du vivant : elle protège la vigne des extrêmes — du froid, de la grêle, comme des fortes chaleurs. Ce sont ces équilibres subtils qu'il nous faut apprendre à reconstruire.
Comme dans de nombreux secteurs, nous faisons face à une pénurie de main-d'œuvre. De quatre salariés temps plein pour un vignoble de 10 hectares,
je recrute des saisonniers, entre 6 et 14 personnes, selon les saisons.
Quel regard portez-vous sur votre métier ? Et sur le marché du vin ?
Être vigneron, c'est exercer un métier ancestral, mais c'est aussi — et surtout — une affaire de passion. Le vigneron d'aujourd'hui est un artisan complet, à la croisée des savoirs : il est à la fois ingénieur agronome, vinificateur, commercial, comptable, douanier, psychologue et gestionnaire des ressources humaines. Ce métier exige une main sûre, une main qui sait, comme celle de l'ébéniste, transmettre le geste juste.
Nous aimons partager ce que nous faisons, car le vin est avant tout une œuvre vivante — un langage entre la terre et les hommes. Pourtant, depuis quelques années, le marché traverse des turbulences. Les courants du slow food et du slow wine, porteurs d'une réflexion salutaire sur notre manière de consommer, nous invitent à repenser notre offre, à l'ajuster à des attentes nouvelles, plus sensibles, plus conscientes.
Dans ce contexte, accueillir les visiteurs au domaine, leur offrir une véritable expérience, devient un levier essentiel de fidélisation. Le lien humain, l'émotion partagée autour d'un vin, sont autant de ponts durables entre le producteur et le consommateur.
Je reviens récemment de New York, où j'ai rencontré des Américains sincèrement peinés par les difficultés que traverse le monde du vin. Là-bas comme ici, on mesure l'importance de ce patrimoine vivant. Je constate aussi une légère reprise de la consommation en Europe. Et malgré les crises, je garde cette part d'optimisme peut-être un peu naïf : la France demeure, plus que jamais, le pays du vin et de la gastronomie. Et cela, j'ose croire, ne changera pas de sitôt.